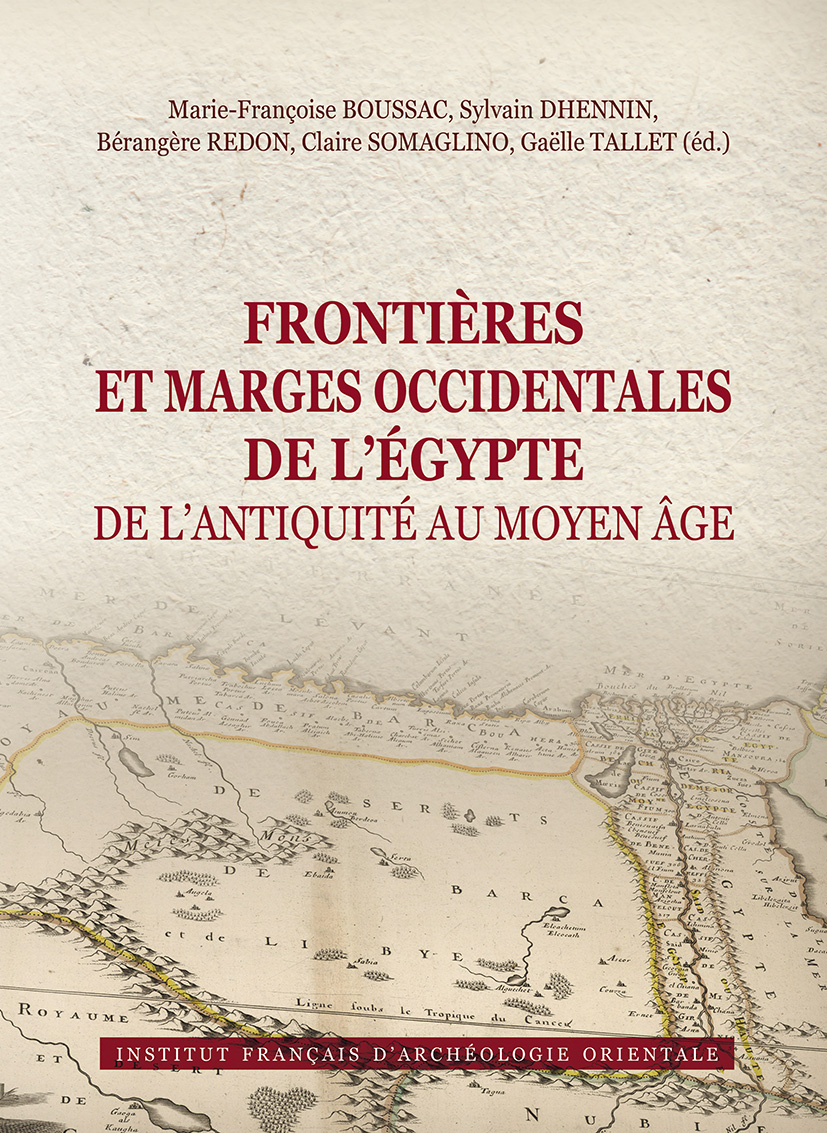Catalogue des publications
Les achats en ligne sont suspendus, sauf pour les fichiers. Retour le 4 janvier 2026. J'ai un code promotionnel.
On line orders are suspended, except for files. Back on 4th of January 2026. I have a promotional code.
extrait du catalogue (recherche de “9782724708486”)
ISBN 9782724708486
2023 IFAO
Collection: BiEtud 181
Langue(s): français
1 vol. 384 p.
49 € (2579 EGP)
Marie-Françoise Boussac (éd.), Sylvain Dhennin (éd.), Bérangère Redon (éd.), Claire Somaglino (éd.), Gaëlle Tallet (éd.)
Frontières et marges occidentales de l’Égypte de l’Antiquité au Moyen Âge
Actes du colloque international, Le Caire, 2-3 décembre 2017
Y eut-il, aux différentes époques de l’histoire égyptienne, une frontière occidentale clairement définie d’un point de vue culturel et politique ? Comment les limites ouest du territoire égyptien étaient-elles perçues et vécues par le pouvoir central comme par les populations locales ?
Dans cette optique, les actes du colloque international du Caire des 2-3 décembre 2017 explorent les marges occidentales de l’Égypte selon quatre axes : 1) définition, conception, représentation ; 2) occupation, contrôle, administration ; 3) économie ; 4) populations, réseaux, religion. Ils permettent d’esquisser le portrait d’une région-clé de l’Égypte de l’Antiquité au Moyen Âge. Une fois passée la phase de fixation territoriale de l’État égyptien, la faible densité de population dans le Delta occidental et l’absence de menace réelle n’ont guère incité à définir et défendre une véritable limite occidentale. L’arrivée de nouveaux groupes de populations libyennes aux portes de l’Égypte à l’époque ramesside représente un tournant. L’émergence de la dynastie saïte place la région dans une dynamique nouvelle, celle d’une frontière avec le monde grec et d’un front pionnier, qui préfigure la mise en valeur de ces territoires sous les Ptolémées.
À l’époque impériale, l’Égypte est englobée dans un empire qui s’étend largement plus à l’ouest et dont le centre de décision est extérieur, ce qui modifie le statut des marges ouest. Les incursions nomades dans la Grande Oasis à la fin de la période montrent cependant que la question de la frontière demeure un enjeu. Cet enjeu perdure après la conquête arabe alors que l’Égypte est de nouveau intégrée à un immense empire.
Was there, in different periods of Egyptian history, a clearly defined political and cultural western border? How was the western limit of Egyptian territory perceived and experienced by the central power and local populations?
Keeping these questions in mind, the proceedings of the international conference held in Cairo on 2-3 December 2017 explore the western margins of Egypt along four lines: 1) definition, conception, representation; 2) occupation, control, administration; 3) economy; 4) populations, networks, religion. They allow us to sketch a portrait of a key region of Egypt from Antiquity to the Middle Ages. Once the phase of territorial fixation of the Egyptian state was completed, the low population density in the Western Delta and the absence of a real threat did not encourage the definition and defense of an actual western border. However, the arrival of new Libyan groups at the gates of Egypt during the Ramesside period was a turning point.
The emergence of the Saite Dynasty placed this region in a new dynamic—that of border with the Greek world and pioneer front—which prefigured the development of this territory under the Ptolemies. During the Roman period, Egypt was part of an empire that extended much further west and whose decision-making center was outside the country, which changed the status of the western limit. Still, the nomadic incursions into the Great Oasis at the end of the period show that the question of the frontier remained an issue. This issue continued after the Arab conquest when Egypt became again part of a vast empire.
- Marie-Françoise Boussac (
: 031837123)
Marie-Françoise Boussac est historienne, ancien membre de l'École française d'Athènes et professeur émérite d'histoire grecque à l'université de Paris Nanterre. Spécialiste de l'Orient hellénisé et de l'Égypte gréco-romaine, elle a travaillé sur les archives et les sceaux du monde hellénistique, sur les échanges entre la Méditerranée et l'océan Indien et a été PI pour un programme collaboratif sur les bains (Balneorient : voir https://balneorient.hypotheses.org). Elle a été directrice de la mission française à Taposiris et Plinthine, qu'elle a lancée, de 1998 à 2017. Elle est responsable de la rédaction de la revue Topoi depuis 1991. - Sylvain Dhennin (
: 083372075)
Docteur en égyptologie, ancien membre scientifique de l'Ifao, chargé de recherches au CNRS (UMR 5189 HiSoMA), Sylvain Dhennin dirige le chantier archéologique de Kôm Abou Billou. - Bérangère Redon (
: 140353542)
Ancienne membre scientifique de l’IFAO de 2009 à 2012, Bérangère Redon est chargée de recherche au CNRS (HiSoMA, Lyon) depuis 2012. Historienne et archéologue, elle s’appuie sur l’étude combinée des vestiges et des textes pour mener une étude à la fois historique, culturelle, économique et sociale de la présence grecque et romaine en Égypte. Elle développe des travaux sur l’appropriation (pratique, symbolique, économique) des espaces égyptiens, en particulier des marges et des frontières, par les différents pouvoirs qui se sont succédé sur le trône égyptien de l’époque saïte à l’époque romaine et sur les rencontres culturelles entre les populations établies sur le sol égyptien. Pour nourrir ces travaux, Bérangère Redon travaille depuis 2010 au sein de la mission archéologique française du désert Oriental (IFAO, MEAE), dont elle a assuré la direction de 2013 à 2017. En parallèle, elle participe depuis 2002 à la mission française de Taposiris-Plinthine (IFAO, MEAE), sur la côte méditerranéenne. Elle en a repri - Claire Somaglino (
: 162030401)
Ancienne membre scientifique de l’IFAO, Claire Somaglino est agrégée d’histoire et maîtresse de conférences à l’UFR d’histoire de la faculté des Lettres de Sorbonne Université. Elle est spécialiste de l’étude des frontières de l’Égypte pharaonique et des questions de perception de l’espace, en particulier par l’étude de la toponymie ancienne. Elle participe à la fouille du port pharaonique d’Ayn Soukhna, en mer Rouge, depuis 2011 et en a repris la direction en 2017. Elle est également engagée dans la fouille du site de Plinthine depuis 2016. Claire Somaglino a publié récemment un Atlas de l’Égypte ancienne aux éditions Autrement (2020). - Gaëlle Tallet (
: 119250713)
Gaëlle Tallet est professeur d’histoire ancienne à l’Université de Limoges. Elle dirige depuis 2008, à la suite de Françoise Dunand, la mission archéologique d’El-Deir dans l’oasis de Kharga et est porteuse du projet collaboratif international CRISIS (ANR-15-CE03-0004), en partenariat avec Roger S. Bagnall (New York University), Salima Ikram (American University in Cairo), Corina Rossi (Politecnico di Milano) et Jean-Paul Bravard (UMR 5600 EVS). Ce consortium travaille sur les réponses impériales et provinciales apportées aux défis environnementaux et économiques dans la Grande Oasis, à la frontière de l'Empire romain, du Ier au VIe s. p.C. Elle a publié, avec Roger S. Bagnall, The Great Oasis of Egypt. Dakhla and Kharga during Antiquity, Cambridge, Cambridge University Press, 2018, et avec Thierry Sauzeau, Mers et déserts de l’Antiquité à nos jours : approches croisées. Actes du colloque international de Limoges, 7-9 novembre 2013, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2018.
- Vous pouvez acquérir ce(s) fichier(s) PDF issu(s) de cet ouvrage en cliquant sur le nom du fichier puis 'Ajouter au panier'.
- You can buy theses PDF files extracted from this book by clicking on the file name then 'Add to cart'.