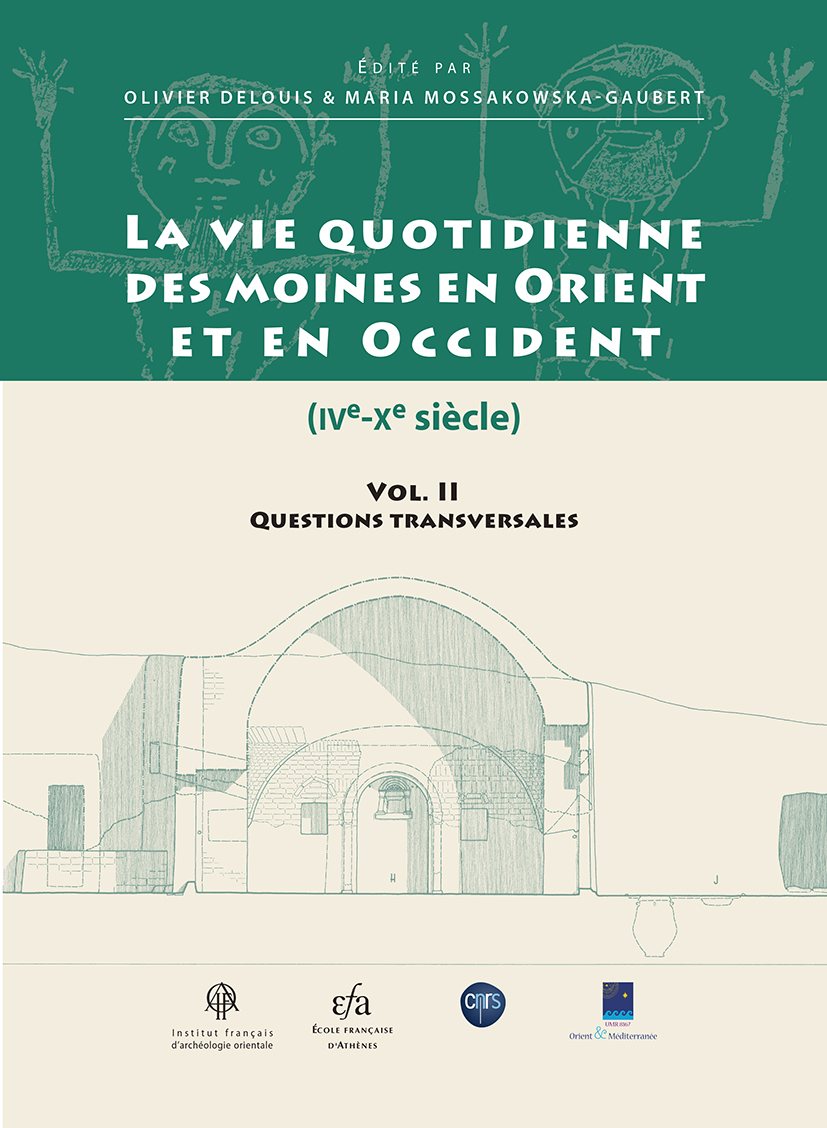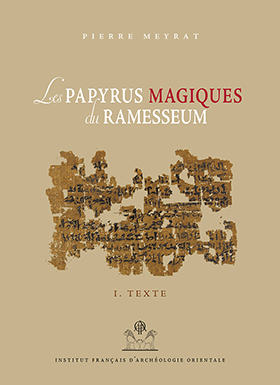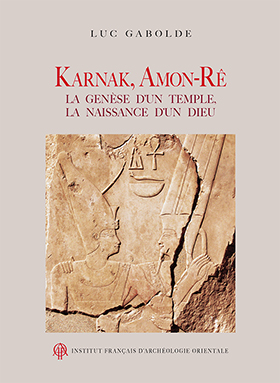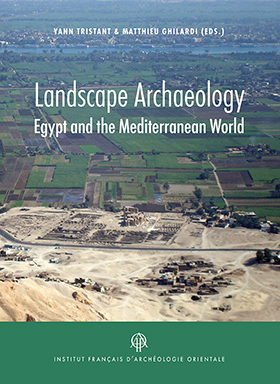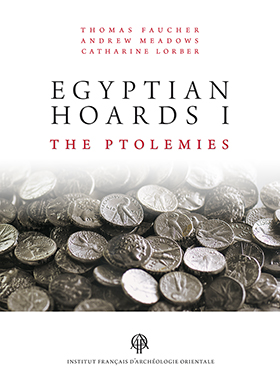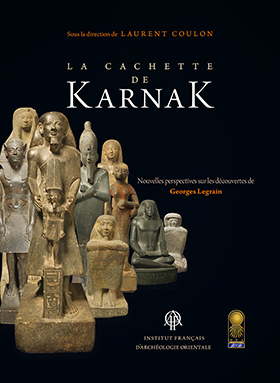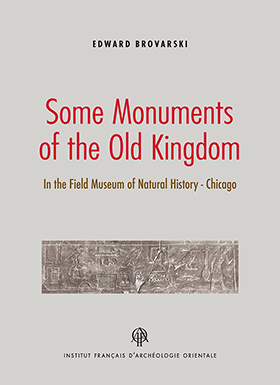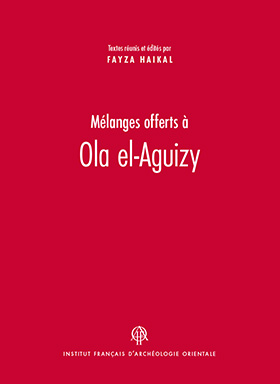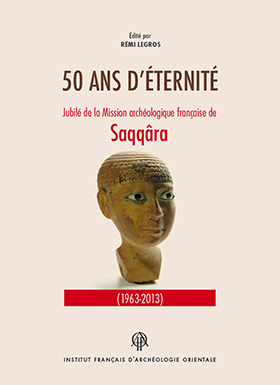Catalogue des publications
- Pour effectuer une commande, remplissez votre panier puis terminez votre commande. Vous pourrez effectuer un paiement sécurisé et être livré dans le monde entier. J’ai un code promotionnel
- To perform an order, fill your cart then proceed the order. You will be driven to a secured page for the electronic payment which includes worldwide shipping fees. I have a promotional code.
Bibliothèque d’étude (BiEtud)
La collection Bibliothèque d’étude (BiEtud) est essentiellement dédiée à la publication de recherches d’excellence portant sur l'Egypte ancienne.
ISBN 9782724707151
2019 IFAO
Collection: BiEtud 170
Langue(s): français, anglais
1 vol. 508 p.
65 € (3250 EGP)
Olivier Delouis (éd.), Maria Mossakowska-Gaubert (éd.)
La vie quotidienne des moines en Orient et en Occident (IVe-Xe siècle). II- Questions transversales
Le programme collectif sur la Vie quotidienne des moines en Orient et en Occident (ive-xe siècle) trouve avec le présent ouvrage son achèvement. Un premier volume avait exposé, par régions géographiques, la variété des sources permettant d’étudier le quotidien des moines des premiers siècles. Dans un second colloque tenu à Paris en 2011, une perspective comparatiste fut appliquée à six thèmes transversaux : le paysage monastique, le corps du moine, la prière, les sociologies monastiques, l’économie productive, la fixation et la diffusion de la norme. Vingt-deux articles interrogent ici ces réalités communes aux moines égyptiens, nubiens, syro-palestiniens, byzantins, nord-africains, wisigothiques, italiens, francs et germaniques, anglo-saxons ou irlandais.
Si la démarche a su varier les angles d’approche, l’ambition d’embrasser toutes les formes de la vie monastique a été maintenue. Elle a permis de saisir le monachisme comme un phénomène non pas unique, mais façonné au contact d’environnements différents. Aussi le quotidien des moines, aux traits souvent répétitifs et peu saillants, illustre-t-il, comme en miroir, l’histoire des sociétés où ils se sont inscrits dans le temps.
With this book, the joint research programme Everyday Life in Eastern and Western Monasticisms (4th-10th century AD) reaches its end. A first volume presented the variety of sources to study daily monastic life for the first centuries, in geographical order. During a second colloquium held in Paris in 2011, a comparative perspective was applied to six transversal topics: monastic landscape, the monk’s body, prayer, sociologies, productive economy, creation and dissemination of monastic rules. The present volume gathers twenty-two articles questioning these issues common to Egyptian, Nubian, Syro-Palestinian, Byzantine, North African, Visigothic, Italian, Frankish and Germanic, Anglo-Saxon or Irish monks. Although the approaches are manyfold, we have maintained our ambition to consider all forms of monastic life. Therefore, it was possible to grasp monasticism as a diverse phenomenon, which has been shaped by various environments. If daily monastic life is repetitive and does not always present salient features, it nonetheless mirrors the history of societies within which monks have settled down.
- Olivier Delouis (
: 101881452)
Ancien membre de l’École française d’Athènes, il est chargé de recherche au CNRS (UMR 8167 Orient et Méditerranée, Paris). Spécialiste du monachisme byzantin, il dirige la Revue des études byzantines. - Maria Mossakowska-Gaubert (
: 187403511)
Archéologue et historienne, formée à l’université de Varsovie, ancien membre scientifique à titre étranger de l’Ifao, Maria Mossakowska-Gaubert est actuellement chercheuse contractuelle à l’université de Copenhague, où elle a bénéficié d'une bourse européenne (Marie Skłodowska-Curie) et dirige le projet RECONTEXT. Elle est spécialiste de la culture matérielle et du monachisme de l'époque antique tardive – début de l’époque arabe en Égypte.
ISBN 9782724707373
2019 IFAO
Collection: BiEtud 172
Langue(s): français
2 vol. 448 p.
62 € (3100 EGP)
Pierre Meyrat
Les papyrus magiques du Ramesseum
Recherches sur une bibliothèque privée de la fin du Moyen Empire
Rédigés à la fin du Moyen Empire et découverts dans un coffret de bois au fond d’un puits funéraire lors de fouilles anglaises menées en 1895-1896 sur la rive ouest de Thèbes, les papyrus du Ramesseum constituent pour la moitié d’entre eux – à savoir un texte en hiéroglyphes cursifs et douze textes en hiératique – la plus ancienne collection de papyrus magiques connue à ce jour. Souvent comparés aux deux autres bibliothèques magiques connues (les papyrus Chester-Beatty pour le Nouvel Empire et les papyrus Wilbour pour la Basse Époque), les papyrus magiques du Ramesseum, aujourd’hui conservés au British Museum, ont été publiés sous forme de planches par Sir Alan H. Gardiner en 1955, et font ici pour la première fois l’objet d’une étude systématique. En raison de leur état très fragmentaire, le déchiffrement de ces documents relève parfois de la gageure. Si la plupart des formules présentées ici ne sont pas connues par ailleurs, plusieurs parallèles ont pu être identifiés dans d’autres sources plus anciennes ou plus tardives. De nouvelles hypothèses sont également proposées sur l’utilisateur de ces documents et sur leur origine géographique.
The Ramesseum papyri were composed in the late Middle Kingdom and discovered in a wooden box at the bottom of a tomb shaft during British excavations carried out in 1895-1896 on the west bank of Thebes. Half of them, i.e. one cursive and twelve hieratic documents, comprise the earliest collection of magical papyri known to this day. Often compared to the other two famous magical libraries known (the Chester-Beatty papyri for the New Kingdom and the Wilbour papyri for the Late Period), the magical papyri from the Ramesseum, today preserved at the British Museum, were published in 1955 by Sir Alan H. Gardiner in a volume of plates, and are here studied systematically for the first time. Due to their poor state of conservation, the deciphering of these very fragile and fragmentary documents often represents a conundrum. Although most of the spells are apparently unique to these papyri, several parallels could be identified in earlier or later sources. New hypotheses are also proposed on the user of these documents and on their geographic origin.
- Pierre Meyrat (
: 234901462)
Né en 1977 à Neuchâtel (Suisse), Pierre Meyrat a étudié l’égyptologie, l’arabe et l’anglais à l’Université de Genève avant de compléter sa formation par un diplôme en traduction. Il a soutenu en mai 2012 sa thèse de doctorat sur les papyrus magiques du Ramesseum. Actuellement traducteur indépendant, il participe à différentes missions archéologiques ou épigraphiques en Égypte et au Soudan.
ISBN 9782724706864
2018 IFAO
Collection: BiEtud 167
Langue(s): français
1 vol. 744 p.
64 € (3200 EGP)
Luc Gabolde
Karnak, Amon-Ré : la genèse d'un temple, la naissance d'un Dieu
L’ancienneté du temple de Karnak et la genèse du culte d’Amon ont longtemps fait l’objet de débats aux conclusions incertaines, faute d’indices déterminants, mais il est désormais possible de proposer de nouvelles hypothèses sur le développement du site et l’essor du culte d’Amon. Le Nil a connu des changements importants de son cours et il semble que le site de Karnak, primitivement situé rive gauche, soit devenu une île inhabitée durant l’Ancien Empire. Sous la XIe dynastie, après le rattachement de l’île à la rive droite, les nouveaux dynastes thébains mirent à profit les terres émergées pour édifier un sanctuaire, consacré à Amon-Rê, garant de leur légitimité. Cette divinité, quoique nouvelle, n’a pas été élaborée ex nihilo : elle synthétise le concept memphito-héliopolitain d’Imn, « caché », la dimension solaire empruntée à Rê-Atoum d’Héliopolis, l’iconographie et les liturgies coptites du dieu Min. Amon-Rê devint ainsi, pour ces souverains originaires du Sud, le dieu qu’ils avaient révélé et que les rois précédents n’avaient pas su reconnaître.
The age of the Karnak temple and the genesis of the cult of Amon have been the subject of debate and inconsistent conclusions for years, due to the lack of decisive elements, but it is now possible to present some new hypotheses on the development of the site and the rise of the cult of Amon. The course of the Nile clearly endured some major changes and it appears that the site of Karnak, that was originally located on the left bank, became a desert island during the Old Kingdom. In the XIth Dynasty, after the island became part of the right bank, the new Theban kings took advantage of the emerged land to build a sanctuary, dedicated to a new divinity, which was supposed to guarantee their legitimacy. The divinity, Amon-Re, though a new one, was not created ex nihilo. Amon-Re summarizes the Memphite Heliopolitan concept of Imn, «hidden», and the solar dimension that is a feature of Re-Item of Heliopolis, as well as the iconography and the Coptite liturgies of Min. For those sovereigns coming from the South, Amon-Re became the god that they contributed to reveal, to the contrary of the previous kings, who did not rightly appreciate it.
- Luc Gabolde (
: 032508026)
Luc Gabolde est égyptologue, directeur de recherche au CNRS, directeur de l’Unité de service et de recherche 3172 du CNRS basée à Karnak et co-directeur du Centre franco-égyptien d’étude des temples de Karnak (CFEETK). Il a été membre chercheur de la mission permanente du CNRS à Karnak de 1993 à 2003. L. Gabolde est l’auteur d’une cinquantaine d’articles et de trois monographies sur le temple d’Amon-Rê dont deux parues à l’IFAO (Le « Grand-château d’Amon » de Sesostris Ier à Karnak, MAIBL 17, 1998 ; Les monuments en calcaire en bas-reliefs aux noms de Thoutmosis II, Hatchepsout et Thoutmosis III à Karnak, IFAO, MIFAO 123, 2006 ; Karnak, Amon-Rê : La genèse d’un temple, la naissance d’un dieu, IFAO, BiEtud 167, 2018).
ISBN 9782724707083
2018 IFAO
Collection: BiEtud 169
Langue(s): anglais
1 vol. 296 p.
54 € (2700 EGP)
Yann Tristant, Matthieu Ghilardi
Landscape Archaeology
Egypt and the Mediterranean World
This book deals with the archeology of ancient landscapes in the Egyptian and Mediterranean regions. Geoarchaeological methodologies have emerged as a major component in any archaeological approaches to better understanding both the dynamics of the establishment of ancient environments and the variety of settlement patterns adopted by human societies. Thirteen contributions are grouped into four parts entitled “Geoarchaeology and reconstitution of the ancient landscape”; “Geographic Information Systems (GIS)”; “Historical Geography”; and “Geoarchaeology Case Studies”. The examples highlighted in this book address the following themes: rural site formation; water management strategies; paleo-environment reconstruction; land occupation; and settlement location. The authors give an overview of the complex relationships between landscape dynamics and the logics of human occupation through the results of recent studies carried out in Egypt, Tunisia, Morocco, Greece and Portugal.
Le présent ouvrage s’intéresse à l’archéologie des paysages antiques, en Égypte et sur le pourtour méditerranéen. L’approche géoarchéologique s’est imposée comme une étape majeure de toute démarche archéologique pour mieux comprendre tant la dynamique du peuplement des milieux anciens que les différents systèmes d’aménagements proposés par les sociétés humaines. Treize contributions sont regroupées dans quatre parties intitulées « Géoarchéologie et reconstitution des paysages anciens », « Systèmes d’information géographiques (SIG) », « Géographie historique » et « Études de cas en géoarchéologie ». Ces différents cas d’étude permettent d’aborder les questions suivantes : la formation de sites ruraux, les politiques de gestion de l’eau, la reconstitution des paléoenvironnements, l’occupation des territoires et la localisation du peuplement. Les auteurs dressent un panorama des relations complexes entre les dynamiques et les processus paysagers et les logiques d’occupation humaine à travers l’exemple d’études récentes menées en Égypte, en Tunisie, au Maroc, en Grèce et au Portugal.
- Yann Tristant (
: 083160116)
Yann Tristant est professeur associé à la Macquarie University (Sydney, Australie). Archéologue et protohistorien, il s’intéresse à la période pré- et protodynastique en Égypte et aux relations entre l’homme et son environnement dans le cadre nilotique. Chef de chantier pour l’Ifao à Abou Rawach et dans le Ouadi Araba, ses recherches se portent aussi sur la géoarchéologie du Delta du Nil et de la région de Dendara en Haute-Égypte. - Matthieu Ghilardi (
: 111321743)
Matthieu Ghilardi est chargé de recherche au CNRS (CNRS, CEREGE, UM34 & UMR 7330, Aix-en-Provence). Géographe et géomorphologue, il étudie plus particulièrement les îles de la Méditerranée (Corse, Chypre, Eubée, Crète, Baléares, Thasos et Sardaigne). Ses recherches portent également sur la géoarchéologie des grands fleuves du pourtour méditerranéen, et notamment le Nil dans le secteur de Karnak-Coptos.
ISBN 9782724706895
2017 IFAO
Collection: BiEtud 168
Langue(s): anglais
1 vol. 608 p.
69 € (3450 EGP)
Thomas Faucher, Andrew R. Meadows, Catharine Lorber
Egyptian Hoards I
The Ptolemies
The first volume of Egyptian Hoards offers a complete list of 278 hoards containing Ptolemaic coins in gold, silver, or bronze, found in Egypt and in the sphere of influence of the Lagid kings. Forty-nine of these hoards are documented here for the first time. The volume consists predominantly of articles presenting and analyzing the new hoards, enlarged hoards, and older hoards restudied in light of recent numismatic scholarship. For the most part the articles are generously illustrated: the plates feature more than 3500 coins in color. Following in the tradition of the Inventory of Greek Coin Hoards (IGCH) and the ten volumes of Coin Hoards (CH), Egyptian Hoards I collects and analyzes the coin hoards which constitute a major contribution to the study of the monetarization of Egypt and the circulation of coinage in the country, with very important implications for our understanding of the economy of the region.
Le premier volume d’Egyptian Hoards offre la liste complète des 278 trésors (dont 49 inédits) composés de monnaies ptolémaïques en or, en argent et en bronze, trouvés en Égypte et dans les zones d’influence des rois lagides. Outre cette liste, l'ouvrage se compose essentiellement d’articles présentant des trésors inédits, augmentés ou réédités, pour la plupart largement illustrés (les planches proposent plus de 3 500 monnaies en couleur). Issu de l’héritage livré par l’Inventory of Greek Coin Hoards (IGCH) et les dix volumes des Coin Hoards (CH), le rassemblement et l’étude de ces trésors monétaires constituent un apport majeur à l’étude de la monétarisation de l’Égypte, à la circulation des monnaies dans le pays ainsi que, plus largement, à l’économie de la région.
- Thomas Faucher (
: 116523085)
Archéologue et numismate, il est chargé de recherche à l'IRAMAT-CRP2A (CNRS/Université Bordeaux Montaigne). Centrées sur l’histoire économique et monétaire, ses recherches traitent en particulier de la production et de la circulation de la monnaie en Égypte ancienne, ainsi que des méthodes d'extraction des minerais ayant servi à leur fabrication. Membre de la mission française du désert Oriental depuis 2011, il la dirige depuis 2018. - Andrew R. Meadows (
: 059365730)
- Catharine Lorber (
: 071009191)
ISBN 9782724706574
2016 IFAO
Collection: BiEtud 161
Langue(s): français
1 vol. 616 p.
79 € (3950 EGP)
Laurent Coulon
La Cachette de Karnak
Nouvelles perspectives sur les découvertes de Georges Legrain
La Cachette de Karnak, fouillée par Georges Legrain entre 1903 et 1907, est l’une des plus fascinantes découvertes de l’archéologie égyptienne. La première raison en est l’abondance des objets qu’elle a livrés (statues, stèles, mobilier divers), en partie encore inédits, qui sont autant de documents d’importance majeure sur la vie religieuse du sanctuaire de Karnak, mais plus généralement aussi sur l’histoire et l’art de l’Égypte pharaonique entre le Moyen Empire et l’époque ptolémaïque. La deuxième raison est liée au mystère qui entoure encore sa raison d’être et les circonstances historiques de sa création. Si elle peut être rapprochée sur certains aspects d’autres cachettes retrouvées en Égypte ou au Soudan, son ampleur et sa richesse restent exceptionnelles.
S’appuyant sur un programme de recherche lancé par l’Ifao et le Ministère des Antiquités de l’Égypte pour mieux cerner la Cachette de Karnak et son contenu, cet ouvrage réunit vingt-quatre contributions de spécialistes internationaux impliqués dans l’étude d’objets qui en proviennent ou travaillant sur ce dépôt comme sur d’autres cachettes égyptiennes d’un point de vue idéologique ou archéologique.
The Karnak Cachette, excavated by Georges Legrain between 1903 and 1907, is one of the most fascinating discoveries of Egyptian archaeology. The first reason lies in the very high number of objects found in it (statues, stelae, furniture of various kinds), some of them still unpublished, all of which are documents of major importance for the religious life of Karnak, but also more generally for the history and art of Pharaonic Egypt between the Middle Kingdom and the Ptolemaic period. The second reason is that the raison d’être of this cache and the historical circumstances surrounding its creation remain mysterious. Even if some comparisons can be made with other caches found in Egypt and the Sudan, its magnitude and wealth are exceptional. Building on a research program launched by the Ifao and the Egyptian Ministry of Antiquities to improve our knowledge of the Karnak Cachette and its content, this book comprises twenty-four contributions by international scholars studying objects found in this deposit, analyzing the Cachette itself, or investigating other Egyptian caches from an ideological or archaeological point of view.
- Laurent Coulon (
: 057589275)
Ancien élève de l'École Normale supérieure, membre scientifique puis directeur de l’Institut Français d’Archéologie Orientale, Laurent Coulon est actuellement professeur au Collège de France et directeur d'études à l'École Pratique des Hautes Études, PSL. Ses travaux s’attachent à l'histoire de la religion de l’Égypte pharaonique à travers l'étude du culte d'Osiris au Ier millénaire avant J.-C., notamment à Karnak. Il est également spécialiste de la rhétorique et de l’éloquence égyptiennes.
ISBN 9782724706833
2016 IFAO
Collection: BiEtud 166
Langue(s): anglais
1 vol. 128 p.
21 € (1050 EGP)
Edward Brovarski
Some Monuments of the Old Kingdom in the Field Museum of Natural History, Chicago
The Field Museum of Natural History, Chicago, possesses a substantial collection of reliefs and other objects of Old Kingdom date. These are little published and largely unknown to the Egyptological community. The present volume incoporates the reliefs, false doors, lintels, and drum rolls from seven different Old Kingdom tombs deriving from the sites of Giza and Saqqara. In date they range from the 4th to 6th Dynasties. Other monuments from the same tombs in museums in the United States and Europe are assembled here. Taken as a whole, the Field Museum objects are revealing of the socio-economic status of their owners, who include both high-ranking officials and others of a more modest rank, and disclose something of their religious beliefs and moral tenets as well. They also attest to the active antiquities trade of the late 19th century.
- Edward Brovarski (
: 031015395)
ISBN 9782724706635
2015 IFAO
Collection: BiEtud 164
Langue(s): français
1 vol. 512 p.
75 € (3750 EGP)
Fayza Haikal
Mélanges offerts à Ola el-Aguizy
Ce volume de mélanges présente près d’une quarantaine d’articles offerts au Professeur Ola el-Aguizy par ses amis et collègues afin de lui témoigner leur considération pour sa contribution à l’Égyptologie, aussi bien dans le domaine scientifique que dans les relations internationales qu’elle a su créer entre l’université du Caire et de nombreuses autres institutions académiques à travers le monde.
Professeur émérite à la Faculté d’archéologie de l’université du Caire, où elle a fait toute sa carrière, Ola el-Aguizy a largement contribué à la formation de ses étudiants et au suivi de leurs recherches par sa rigueur scientifique. Devenue doyenne de la faculté, elle a pris la responsabilité du chantier de fouilles de l’université du Caire à Saqqara. Cette nouvelle expérience lui a permis de s’ouvrir à l’archéologie après avoir mené une carrière de philologue. Les contributions offertes dans ce volume reflètent cette double orientation.
This volume presents about forty articles offered to Professor Ola el-Aguizy by her friends and colleagues to express their respect for her contribution to Egyptology, whether in the scientific domain or in the international links she created between Cairo University and many other academic institutions across the world.
Emeritus Professor at the Cairo University Faculty of archeology in which she made all her career, Ola el-Aguizy greatly contributed to the formation of her students and to the mentoring of their research through her scientific strictness. Since she was Dean of the Faculty, she became responsible of the Cairo University’s excavation concession in Saqqara. This new experience allowed her to immerse herself in archeology after having been a philologist. The contributions offered in this volume reflect this double orientation.
- Fayza Haikal (
: 077301064)
ISBN 9782724706581
2015 IFAO
Collection: BiEtud 162
Langue(s): français
1 vol. 376 p.
65 € (3250 EGP)
Rémi Legros (éd.)
Cinquante ans d'éternité
Fouilles de Saqqara
Depuis 50 ans, la Mission archéologique française de Saqqâra fouille inlassablement les sables du désert égyptien. Conçue en 1963 par ses deux éminents fondateurs, Jean Leclant et Jean-Philippe Lauer, elle s’est consacrée longuement à l’étude des Textes des Pyramides, enrichissant par ses découvertes régulières les travaux des premiers philologues.
Le dégagement continu de la nécropole de Pépy Ier a permis également d’élargir notre vision du monde funéraire tel que le concevaient les anciens Égyptiens. La multitude des monuments, des textes, des bas-reliefs ou des objets révèle des femmes et des hommes qui nous racontent un fragment de leur espérance d’éternité.
Les contributions de cet ouvrage rassemblent autour d’un même projet les acteurs passés et présents de la MafS. Leur richesse et leur variété témoignent de l’envergure et du dynamisme dont la mission a su faire preuve tout au long de son histoire.
For 50 years, the French Archaeological Mission in Saqqara tirelessly excavates the sands of the Egyptian desert. Started in 1963 under the impulse of its two eminent founders, Jean Leclant and Jean-Philippe Lauer, the mission goal was long devoted to the study of the Pyramid Texts, thus largely improving the work of the firts philologists.
The continuous clearing of the necropolis of Pepy I also widely allowed to broaden our understanding of the funerary world as conceived by the ancient Egyptians. The multitude of monuments, texts, reliefs or objects richness women and men who are sharing with us a fragment of their hope of eternity.
Contributions to this work gather past and present members of the FAMS around a common project. Their richness and variety testify of the scope and dynamism the mission has demonstrated throughout its history.
- Rémi Legros (
: 154744263)
ISBN 9782724706550
2015 IFAO
Collection: BiEtud 163
Langue(s): français
1 vol. 576 p.
78 € (3900 EGP)
Olivier Delouis (éd.), Maria Mossakowska-Gaubert (éd.)
La vie quotidienne des moines en Orient et en Occident
I. Etat des sources
Le monachisme chrétien est né en Égypte vers la fin du IIIe siècle. Celui-ci s’est ensuite rapidement propagé dans toute la Méditerranée orientale, puis au-delà. Devenir moine impliquait alors non seulement un choix spirituel, mais aussi l’acceptation d’un mode de vie conforme à des exigences pratiques énoncées de manière plus ou moins formelle.
Issu d’un colloque tenu à Athènes en 2009 dans le cadre du programme collectif Vie quotidienne des moines en Orient en Occident (IVe-Xe siècle), cet ouvrage propose une approche pluridisciplinaire en rassemblant vingt articles autour d’une question fondamentale : l’état des sources disponibles pour étudier les divers aspects du quotidien des moines.
Autour de cette problématique se croisent des témoignages aussi bien archéologiques qu’écrits – normatifs, littéraires et documentaires – répartis en six zones géographiques, allant de la Mésopotamie du Nord jusqu’à l’Irlande. La démarche permet de mieux comprendre les modalités de diffusion du monachisme, une forme de vie chrétienne à la fois essentielle et variée, qui a durablement marqué les sociétés de l’Antiquité tardive et du haut Moyen Âge.
Christian monasticism emerged in Egypt at the close of the 3rd century and spread rapidly to the whole Eastern Mediterranean area and beyond. The choice of a monastic life was more than a spiritual decision; it implied acceptance of a way of life that conformed to more or less formal rules.
Originating from a colloquium that was organized in Athens in 2009 within the framework of a collective program, Everyday Life in Eastern and Western Monasticisms (4th-10th century AD), this book brings twenty articles illustrating an interdisciplinary approach to an important question: the state of the sources available for the study of various aspects of monks’ daily life.
Both archaeological and written evidence—normative, literary and documentary—is presented according to six geographic zones, from northern Mesopotamia to Ireland. This approach yields a better understanding of the dissemination of monasticism, an essential and yet varied form of Christian life, which had a lasting impact on the societies in late Antiquity and the early Middle Ages.- Olivier Delouis (
: 101881452)
Ancien membre de l’École française d’Athènes, il est chargé de recherche au CNRS (UMR 8167 Orient et Méditerranée, Paris). Spécialiste du monachisme byzantin, il dirige la Revue des études byzantines. - Maria Mossakowska-Gaubert (
: 187403511)
Archéologue et historienne, formée à l’université de Varsovie, ancien membre scientifique à titre étranger de l’Ifao, Maria Mossakowska-Gaubert est actuellement chercheuse contractuelle à l’université de Copenhague, où elle a bénéficié d'une bourse européenne (Marie Skłodowska-Curie) et dirige le projet RECONTEXT. Elle est spécialiste de la culture matérielle et du monachisme de l'époque antique tardive – début de l’époque arabe en Égypte.