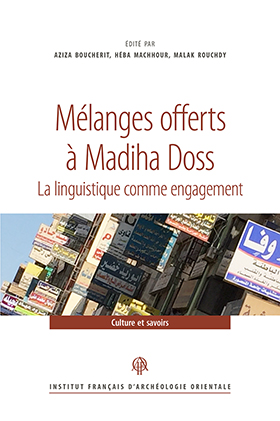Catalogue des publications
- Pour effectuer une commande, remplissez votre panier puis terminez votre commande. Vous pourrez effectuer un paiement sécurisé et être livré dans le monde entier. J’ai un code promotionnel
- To perform an order, fill your cart then proceed the order. You will be driven to a secured page for the electronic payment which includes worldwide shipping fees. I have a promotional code.
ISBN 9782724707274
2018 IFAO
Collection: MIFAO 142
Langue(s): français
1 vol. 668 p.
69 € (3450 EGP)
Bernard Mathieu
Les textes de la pyramide de Pépy Ier
Les parois inscrites des appartements funéraires de la pyramide de Pépy Ier, troisième pharaon de la VIe dynastie (c. 2330-2280), livrent le plus vaste ensemble de Textes des Pyramides actuellement connu. Fondée sur la publication de ces textes en fac-similés (MIFAO 118/1-2), dont une 2e édition est parue en 2010, la présente traduction intègre les compléments fournis notamment par la pyramide de Mérenrê et celle de la reine Ânkhesenpépy II, découverte en 2000 par la Mission archéologique franco-suisse de Saqqâra (MafS). La traduction de près de 800 formules, dont 81 formules « nouvelles » (TP 1001-1081), est précédée d’une présentation générale de l’ensemble du corpus.
The inscribed walls of the inner chambers and corridors of Pepy Ist’s pyramid, the third Pharaoh of the VIth Dynasty (c. 2330-2280), offer the largest set of Pyramid Texts known. Based on the previous publication of these texts in facsimiles (MIFAO 118/1-2), a 2nd edition of which came out in 2010., the present translation includes additional material, especially from Merenre’s and queen Ankhesenpepy II’s pyramids, the last one discovered in 2000 by the French-Swiss archaeological Mission of Saqqâra (MafS). The translation of about 800 spells, including 81 “new” ones (PT 1001-1081), is preceded by a general presentation of the whole corpus.
- Bernard Mathieu (
: 030609607)
Agrégé de lettres classiques, égyptologue, Bernard Mathieu est professeur à l’Université Paul Valéry - Montpellier 3 et ancien directeur de l’Institut français d’archéologie orientale du Caire. Membre de la Mission archéologique franco-suisse de Saqqâra, Bernard Mathieu travaille principalement sur la langue et la littérature de l’Égypte pharaonique, de l’Ancien Empire à la fin du Nouvel Empire, ainsi que sur l’édition, la traduction et le commentaire des Textes des Pyramides. Sa thèse portait sur La poésie amoureuse de l’Égypte ancienne.
ISBN 9782724707236
2018 IFAO
Collection: BIFAO 117
Langue(s): français
1 vol. 432 p.
54 € (2700 EGP)
BIFAO 117
The Bulletin de l’Institut français d’archéologie orientale (BIFAO) has covered the entire field of egyptology since its first appearance in 1901. The BIFAO 117 holds 15 contributions with a chronological spread from the Old Kingdom up to the Byzantine period, and it illustrates the present state of research in the areas of archaeology, epigraphy, lexicography, iconography, religion and philology.
- Les articles de ce volume sont accessibles gratuitement au format PDF.
- The papers of this volume are freely available in PDF format.
>>Voir les détails de ces extraits - See all extract files details
ISBN 9782724707182
2018 IFAO
Collection: CAI 34
Langue(s): français
1 vol. 168 p.
24 € (1200 EGP)
Marie Favereau
La Horde d'or et le sultanat mamelouk
Naissance d'une alliance (660/1261-662/1264)
En 1260, l’empire mongol est au faîte de sa puissance. Mais les descendants de Gengis Khan sont profondément divisés sur le choix du Grand Khan. Ces divisions profitent au sultanat mamelouk en guerre contre les Mongols. Le sultan Baybars parvient alors à se rapprocher d’une des branches les plus puissantes de l’empire mongol, la Horde d’Or, qui est en voie d’islamisation et vise l’indépendance. Cette alliance permet aux Mamelouks de repousser leurs adversaires, d’accroître leur puissance et de sauver le dār al-islām.
À partir d’une reconstitution inédite des premiers échanges diplomatiques entre le sultan mamelouk et le khan de la Horde d’Or, ce livre retrace la rencontre improbable de deux puissances aux cultures radicalement différentes, séparées par des distances immenses pour l’époque, et dont l’alliance aura des effets géopolitiques à long terme au Proche-Orient, en Russie et en Asie Centrale.
In 1260, the Mongol empire was at the heyday of its power. Yet, Chinggis Khan’s descendants could not agree among themselves on the choice of the Great Khan. At war with the Mongols, the Mamluk sultanate took advantage of their divisions. Sultan Baybars managed to create an alliance with the Golden Horde, one of the most powerful branches of the Mongol empire, which was on the path of islamization and seeking for independence. This alliance would allow the Mamluks to repel their adversaries, increase the sultanate’s power, and save the dār al-islām.
By revealing the untold story of the first diplomatic exchanges between the Mamluk sultan and the khan of the Golden Horde, this book uncovers the improbable encounter of two powers with great cultural and physical distances between them. Their alliance would have long-term geopolitical impacts on the Near East, Russia, and Central Asia.
- Marie Favereau (
: 09465929X)
Marie Favereau est docteur en Histoire de l’université de La Sorbonne-Paris IV et de l’università degli Studi di San Marino. Après avoir été membre scientifique de l’Institut français d’archéologie orientale du Caire, elle a travaillé comme chercheur à l’Institut des études avancées de Princeton et à l’université de Leyde. Depuis 2014, elle est membre du projet ERC Nomadic Empires et Research Associate à l’université d’Oxford où elle poursuit ses travaux sur les Mongols, les Mamelouks et l’histoire comparée des empires nomades.
ISBN 9782724707366
2018 IFAO
Collection: BCAI 32
Langue(s): français
1 vol.
gratuit - free of charge
la version papier n’est pas disponible
Sylvie Denoix (éd.)
Bulletin critique des Annales islamologiques 32
Le Bulletin critique des Annales islamologiques (BCAI) vise à rendre compte de toute publication intéressant les études arabes et islamiques dans les divers domaines : langue et littérature arabes ; islamologie ; philosophie ; histoire ; histoire des sciences et des techniques ; anthropologie et sciences sociales ; arts et archéologie. Le BCAI est conçu et préparé par l’équipe Islam médiéval de l’UMR 8167 Orient Méditerranée du Cnrs. Il est mis en page et mis en ligne par l’Ifao.
The Bulletin critique des Annales islamologiques takes into account all publications of interest to Arab and Islamic studies in a variety of domains: Arabic language and literature; Islamic studies; philosophy; history; history of science and technology; anthropology and social sciences; arts and archaeology. It is edited by the team of Islam médiéval (UMR 8167 Orient Méditerranée - Cnrs) and published on line by IFAO.
- Sylvie Denoix (
: 055672221)
Sylvie Denoix est directrice de recherche au Cnrs dans l’équipe Islam médiéval de l’UMR Orient & Méditerranée. Historienne, spécialiste du monde arabe médiéval, ses recherches ont d’abord porté sur l’histoire urbaine des villes du monde musulman, particulièrement du Caire et de Fustat. Elle a notamment dirigé l’Atlas des mondes musulmans médiévaux et est co-directrice de la Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée.
ISBN 9782724707229
2018 IFAO
Collection: FIFAO 77
Langue(s): français
2 vol. 648 p.
89 € (4450 EGP)
Julie Monchamp
Céramiques des murailles du Caire (fin Xe - début XVIe siècle)
Les fouilles archéologiques entreprises par la fondation Aga Khan et l’Institut français d’archéologie orientale entre 2000 et 2009, le long de la muraille médiévale du Caire, ont révélé la présence d’un précédent rempart, bâti en briques crues, dont l’existence n’était jusqu’alors signalée que par les sources écrites. Outre le dégagement de cette enceinte, les fouilles ont permis d’exhumer des bâtiments funéraires fatimides, des structures artisanales ayyoubides, ainsi que des habitats et ateliers d’artisans mamelouks.
La mise au jour de ces vestiges s’accompagne de la découverte de nombreux fragments de céramiques des époques fatimide, ayyoubide et mamelouke, en partie datés par l’analyse stratigraphique des contextes archéologiques. L’étude du matériel présenté dans ce volume permet de retracer sur plus de cinq siècles l’évolution d’un répertoire morphologique jusqu’ici peu connu. Il en ressort une grande diversité de formes et de productions glaçurées, ainsi que des spécificités propres à chacune des trois périodes chronologiques. L’ étude apporte aussi un éclairage sur la vie quotidienne et sur le contexte socio-économique d’un quartier de la capitale aux époques considérées.
The archaeological excavations undertaken by Aga Khan Cultural Services and the French Institute of Oriental Archeology in Cairo between 2000 and 2009 along the Ayyubid walls of Cairo, revealed an earlier mud brick rampart which, until then, had only previously been spoken of in written sources. Moreover, these excavations revealed Fatimid tombs, Ayyubid artisan structures, as well as houses and workshops from the Mamluk era.
A large quantity of pottery sherds from the Fatimid, Ayyubid and Mamluk eras were also discovered and dated thanks to the stratigraphic analysis of the site. The study of the material presented in this volume shows the chronological development of the shapes of common and glazed wares over more than five centuries. It also reveals a great diversity of forms and glazing techniques as well as specific aspects of each of the periods presented. Lastly, it helps shed light on the daily life and socio-economic context of this district of the capital during the relevant periods.
- Julie Monchamp (
: 162036388)
Céramologue et docteur en archéologie islamique. Diplômée de l’université Paris IV-Sorbonne en 2011, Julie Monchamp a par la suite été membre scientifique de l’Ifao. Ses recherches portent sur le mobilier céramique médiéval en Égypte et au Proche-Orient.
ISBN 9782724707199
2018 IFAO
Collection: CCE 11
Langue(s): français
1 vol. 344 p.
la version papier n’est pas disponible
Romain David
Céramiques égyptiennes au Soudan ancien
Importations, imitations et influences
Ce volume réunit différentes recherches entreprises sur les céramiques égyptiennes et méditerranéennes découvertes au Soudan, ainsi que sur l’influence que celles-ci ont eu sur les productions du Soudan ancien, depuis le Moyen Empire jusqu’à la fin de la période médiévale. Ces thématiques invitent naturellement à une réflexion sur la vitalité des échanges entre les royaumes égyptiens et soudanais, sur leur fluctuation sur une longue durée, et sur les processus de transferts de savoir-faire techniques au cours de leur histoire commune. Jusqu’à présent essentiellement abordées sous un angle égyptien, ces problématiques se trouvent ici enrichies de l’apport des fouilles récentes menées en Nubie, aux abords de la quatrième cataracte, au Soudan central et dans les zones désertiques. Cet ouvrage présente ainsi une première synthèse sur le mobilier de régions encore peu documentées et sur un thème qui intéressera à la fois les spécialistes des études égyptologiques et nubiennes.
This volume combines the results of different researches undertaken on Egyptian and Mediterranean ceramics unearthed in Sudan as well as studies on the influences that such material had on the local Sudanese production from the Middle Kingdom up to the end of medieval times. Such topics foster reflections on themes such as exchanges between Egypt and Sudan and their fluctuations on the long term, and the transfer of know-how in the course of their common history. So far essentially addressed from an Egyptian point of view, these issues are here enriched by the contribution of recent excavations conducted in Nubia, on the outskirts of the fourth Cataract, in central Sudan and in the desert areas. This book presents a first synthesis of the material of still poorly documented regions and on a theme that will interest both the specialists of Egyptian and Nubian studies.
- Romain David (
: 168419785)
Ceramic specialist of the late periods in Egypt and in Sudan, Romain DAVID is currently researcher at the Section française de la direction des antiquités du Soudan (SFDAS) at Khartoum.
ISBN 9782724707212
2018 IFAO
Collection: RAPH 42
Langue(s): français
1 vol. 312 p.
27 € (1350 EGP)
Aziza Boucherit, Heba Machhour, Malak Rouchdy
Mélanges offerts à Madiha Doss
La linguistique comme engagement
Ces Mélanges offerts à Madiha Doss sont d’abord l’hommage affectueux d’amis et de collègues qui lui sont humainement et intellectuellement liés. Ils ont voulu lui exprimer leur reconnaissance pour la part qu’elle a prise dans l’histoire actuelle de l’Égypte, au sein de la société civile et particulièrement de l’université égyptienne et, surtout, pour sa contribution au développement des études sur l’arabe d’Égypte, dans tous ses registres et ses usages réels, oraux et écrits, passés et présents.
Au-delà de leur diversité, les contributions rassemblées mettent en avant, chacune à sa manière, un aspect des domaines dans lesquels son action s’est exercée et auxquels les thèmes et les sujets abordés font écho. Outre quelques témoignages d’amitié et des articles de sociologie politique témoignant de son parcours, le volume contient principalement des études de spécialistes de linguistique arabe couvrant des domaines dans lesquels l’activité de recherche de Madiha Doss a été féconde et novatrice : représentations et normes linguistiques, écriture dialectale, oralité dans l’écrit, moyen arabe.These Mélanges Offered to Madiha Doss are first and foremost the affectionate tribute of friends and colleagues, personally and intellectually linked to her. They wished to express their gratitude for the part she has taken in Egypt’s current history, in the civil society and more specifically in the Egyptian academic world; and, above all, for her contribution to the development on studies of the Arabic language of Egypt, in all its registers and real uses, oral and written, past and present.
The addressed themes and topics reflect the areas she has been influential in; beyond their diversity, the gathered contributions, each in its own way, highlight one aspect of these fields. Besides tokens of friendship as well as articles of political sociology that are a testimony to her career, this volume mainly contains studies of specialists by Arabic linguistics covering domains where Madiha Doss’s research activity has been seminal and pioneering: representations and linguistic norms, Arabic colloquial writing, orality in the written form, Middle Arabic.
ISBN 9782724707205
2018 IFAO
Collection: MIDEO 33
Langue(s): français, anglais
1 vol. 336 p.
39 € (1950 EGP)
Emmanuel Pisani (éd.)
Mélanges de l'Institut dominicain d'études orientales 33
Dans le contexte contemporain d’émergence d’une théologie musulmane des religions, ce numéro du MIDÉO aborde cette thématique à partir d’un regard historique qui permet d’évaluer la place accordée aux religions du point de vue islamique. À côté des réfutations (rudūd) à l’encontre des juifs, chrétiens, zoroastriens ou factions musulmanes hétérodoxes, de la vision classique où toutes les religions sont perçues comme des expressions ou manifestations religieuses déformées de la vraie religion qu’est l’islam, l’histoire est aussi celle de courants ou de penseurs qui envisagent les autres religions dans leur authenticité. Il s’agit dès lors d’apprécier un apport original et nécessaire de chaque religion dans une histoire pensée comme voulue par Dieu. Comme le montrent certaines contributions, le renouvellement de cette perspective n’est pas sans incidence sur le regard et le statut normatif accordé aux non-musulmans.
Ce numéro est accessible sur OpenEdition : https://journals.openedition.org/mideo/2606
In the contemporary context of the emergence of a Muslim theology of religions, this edition of MIDEO approaches this theme from a historical point of view which allows us to evaluate the place given to religions from the Islamic perspective. Along with the refutations (rudūd) against Jews, Christians, Zoroastrians, or heterodox Muslim factions, a with the classical view that all religions are perceived as distorted religious expressions or manifestations of the true religion, which is Islam, history also has its trends and thinkers who consider other religions in their authenticity. It is therefore a question of appreciating each religion’s original and necessary contribution in a history that is considered as willed by God. As some contributions show, the renewal of this perspective has an impact on the perception and normative status accorded to non-Muslims.
This issue is available on OpenEdition : https://journals.openedition.org/mideo/2606
في السياق المعاصر لظهور علم الكلام الإسلاميّ للأديان، يتناول هذا العدد من مجلّة المعهد الدومنيكيّ هذا الموضوع من منظورٍ تاريخيّ يقوّم المكانة الممنوحة للأديان من وجهة نظر إسلاميّة. من الردود على اليهود والمسيحيّين والزرادشتيّين إلى البدع الإسلاميّة وحتّى الرؤية التقليديّة الّتي تنظُر إلى جميع الأديان باعتبارها تعبيراتٍ أو مظاهرَ دينيّةً انبثقتْ عن الدين الحقيقيّ الّذي هو الإسلام، كما أنّ هناك أيضًا في التاريخ تيّاراتٍ أو مفكّرين يذهبون إلى صحّة الديانات الأخرى ومن ثمَّ فالمسألة بالنسبة لهم هي تقدير المساهمة الأصليّة والضروريّة لكلّ دين حسب مشيئة الله. وكما توضّح بعض المداخلات فإنّ تجديد هذا المنظور له تأثيرٌ على موقف الإسلام والمسلمين من غير المسلمين.
- Emmanuel Pisani (
: 167138731)
Directeur de l’Institut de science et de théologie des religions de Paris, il est membre de l’unité de recherche « Religion, Culture et Société » (EA7403), directeur du laboratoire de recherche « Islam et Altérité », membre du Conseil d’orientation de la Fondation de l’Islam de France et conseiller scientifique de la Plateforme universitaire de la recherche sur l’Islam en Europe et au Liban (PLURIEL). Il a reçu en 2016 le Prix Muhammad Arkoun organisé par l’IISMM et le GIS Moyen-Orient et mondes musulmans, pour sa thèse "Hétérodoxes et non-musulmans dans la pensée d’al-Ġazālī".
ISBN 9782724707250
2018 IFAO
Collection: FIFAO 79
Langue(s): français
1 vol. 352 p.
49 € (2450 EGP)
Patrice Lenoble
El-Hobagi : une nécropole de rang impérial au Soudan central
Deux tumulus sur sept
La Fin de Méroé est bien connue en Nubie, par les tombes royales de Qoustoul et Ballana, et par les fouilles de capitales à Faras et au Gebel Adda. Pour documenter la période dans la région de Méroé même, la Section française a sondé en 1987-1990 les monuments du site d’el-Hobagi. Des sept grands tumulus à sépultures souveraines, tous enclos d’un mur d’enceinte très original, deux ont été fouillés. Chaque tombe procure un armement exceptionnel, emblématique de la royauté méroïtique. On compte aussi une série étonnante de récipients en bronze gravés de motifs ou de scènes et ayant servi au culte. L’un d’eux porte l’inscription en hiéroglyphes la plus tardive de l’Empire (REM 1222). La datation du matériel et le radiocarbone situent el-Hobagi au ive siècle, au début, donc de l’époque charnière du transfert de la capitale vers Soba. Le cimetière d’el-Hobagi est postérieur au cimetière nord des qore de Méroé, et contemporain à la fois des dernières pyramides du cimetière ouest et des cimetières Garstang 400 et 500. Y est soulignée la persistance d’un État méroïtique dans le Soudan central, quand la Nubie fait sécession. L’interprétation ne permet pas d’affirmer qu’el-Hobagi succède à Méroé ; pour autant, par leurs rites funéraires, les personnages enterrés là – peut-être des ethnarques Noba comparables aux rois Nobades de Nubie – affirment leur appartenance à l’Empire méroïtique.
The End of Meroe is best known in Nubia from the royal tombs at Qustul and Ballana and by the excavations in the capitals at Faras and Gebel Adda. For documentation on the same period in the region of Meroe, the Section française surveyed in1987-1990, the monuments of the site at el-Hobagi. Of the seven large tumuli covering the graves of kings, all enclosed by a wall of unusual form, two were excavated. Each grave produced exceptional weaponry, insignia of Meroitic royalty. There was also an astonishing series of vessels in bronze engraved with motifs or scenes and used for ritual purposes. One of them bore an inscription in hieroglyphs, the latest known in the Empire (REM 1222). The dating of the material and that derived from radiocarbon analysis place el-Hobagi in the 4th century, at the beginning of the pivotal period of the transfer of the capital towards Soba. The cemetery of el-Hobagi is later than the North Cemetery of the rulers of Meroe, and contemporary with both the latest pyramids in the West Cemetery and of Garstang’s cemeteries 400 and 500. It emphasised the persistence of the Meroitic state in central Sudan, when Nubia was already lost. The interpretation does not allow an affirmation that el-Hobagi succeeded Meroe; but, by their funerary rites, the individuals interred – perhaps of Noba ethnicity comparable to the kings of Nobadia in Nubia – were asserting that they belonged to the Meroitic Empire.
- Patrice Lenoble (
: 161124895)
Archéologue qui a toujours voulu et su garder sa liberté de mouvement, Patrice Lenoble a partagé sa vie professionnelle entre le Soudan, le Liban et la DRAC des pays de Loire. Dans les années 1980, il a consacré la plus déterminante partie de sa carrière à répondre à la question de la Fin de Méroé, les fouilles d'El-Hobagi publiées ici sont le résultat de ce questionnement.
ISBN 9782724707137
2018 IFAO
Collection: MIFAO 138
Langue(s): français
1 vol. 404 p.
49 € (2450 EGP)
Pierre Tallet
La zone minière pharaonique du Sud-Sinaï III
Les expéditions égyptiennes dans la zone minière du Sud-Sinaï du prédynastique à la fin de la XXe dynastie
Ce troisième volume consacré à la zone minière du Sud-Sinaï a pour objectif l’étude des expéditions envoyées par l’État pharaonique vers la Péninsule, des origines de l’histoire égyptienne à la fin du Nouvel Empire, en utilisant l’ensemble de la documentation qui est actuellement à notre disposition. Celle-ci s’est largement renouvelée ces dernières années, à la fois grâce à des missions de prospection effectuées au Sinaï, et grâce à l’abondant matériel obtenu lors de la fouille des sites portuaires récemment identifiés sur la côte de la mer Rouge, à Ayn Soukhna et au ouadi el-Jarf, qui ont servi de points d’embarquement à certaines de ces expéditions. La première partie de cette étude s’intéresse de façon générale à l’organisation de ces opérations, en examinant tour à tour les lieux qu’elles parcouraient, les différentes catégories de main d’œuvre qu’elles incorporaient et les produits qu’elles étaient susceptibles de rapporter dans la vallée du Nil. Un catalogue de l’ensemble des missions attestées – plus d’une centaine au total – est ensuite établi période par période, en regroupant à chaque fois l’ensemble des sources connues.
This third volume, devoted to the mining zone of South Sinai, aims at studying the Pharaonic expeditions sent to the South-Western part of this Peninsula, from the beginning of Egyptian history to the end of the New Kingdom. All available sources were used, notably material uncovered during the excavations of the newly discovered Red Sea harbours of Ayn Soukhna and Wadi el-Jarf (used as departing points for these expeditions), but also evidence found during our survey of a large area surrounding the Serabit el-Khadim plateau. The first part of this study presents a general approach to the organisation of these operations (where they went, the things they were looking for), then follows a catalogue listing all the known expeditions to Sinai – more than one hundred – as well as all the documents relating thereto.
- Pierre Tallet (
: 07926817X)
Ancien élève de l’École normale supérieure (Ulm), agrégé d’histoire et ancien adjoint aux publications de l’IFAO, Pierre Tallet est actuellement titulaire de la chaire d’égyptologie de la Sorbonne. Depuis 2001, dans le cadre d’un programme consacré aux expéditions minières égyptiennes en mer Rouge, il a dirigé ou co-dirigé les missions archéologiques d’Ayn Soukhna et du ouadi el-Jarf – deux ports pharaoniques récemment identifiés sur la côte du golfe de Suez – et mené une prospection au sud de la péninsule du Sinaï.